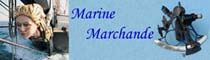Ce navire appartient à France Telecom,
est armé par France Telecom Marine. Il est basé à Brest
et sa mission est l'entretien et le dépannage de câbles de
communication en Atlantique. Voir caractéristiques
principales .
Les câbliers sont des navires très
spécialisés. De plus parmi les câbliers on distingue
deux types de travail, la pose de câbles et leur maintenance. Le Léon
Thévenin est capable de faire les deux, mais ses missions actuelles
sont de la maintenance. A Brest il a son poste bien à lui, avec à
terre des cuves de stockage de câbles, et un chemin de câbles
permettant leur embarquement.
Le personnel marin compte une cinquantaine de personnes, auxquels se joignent
une vingtaine de techniciens pour les missions.
La pose de câbles a beaucoup diminué ces dernières années,
ceux existant sont loin d'être utilisés à leur pleine
capacité. Un seul câble peut acheminer des dizaines de gigabits.
C'est donc la maintenance qui maintient les câbliers en activité. |

Le davier avant, surmonté d'un portique,
qui permet
la manutention des câbles
repéchés
au fond. |
 |
 |

Le davier arrière permettrait la mise à
l'eau
de nouveaux câbles. |
 |
La passerelle de navigation est
équipée de façon
normale.....
|
...avec en plus un système de positionnement dynamique
contrôlé d'ici.
La commande auto ou manuelle des propulseurs
latéraux et des hélices
de propulsion permet de maintenir
le navire exactement à la position voulue. |
Ce système particulier de sonar sert
à répérer
le ROV en plongée. |
Une table à cartes de dimensions inhabituelle,
sert aussi aux briefings avant interventions. |
Un logiciel permet de tenir à jour de façon
précise tout l'historique
de chaque câble et de le visualier
sur écran. |
Station radio GMDSS. |
| On aperçoit les cales, en forme de cuves circulaires,
contenant les câbles |
Ce local, attenant à la timonerie abrite
tous les éléments de commande et de contrôle du ROV.
A l'extrême gauche le pupitre de pilotage proprement dit de l'engin.
Toutes les opérations sont enregistrées et filmées
pour vérification.
L'engin est équipé de multiples
caméras, d'où le nombre d'écrans. |
| Lovage des câbles en cale. |
|
Le pont de travail. Le câble récupéré
au fond est hissé à bord ici par un treuil avec un tambour
de très grand diamètre.
Le mou est récupéré
par une machine qui coince le câble entre des pneus exerçant
une pression d'une tonne.
C'est ici que s'effectue la réparation. |
|
| Voici la machine, les roues viennent coïncer le câble
entre les pneus, pour l'entrainer. |
 |
Le même genre de machine, à l'arrière
du navire, servirait à la pose de câble. Celle là est
équipée de douze paires de pneus. |
 |
| Tableau montrant les différents types de grappins utilisés
pour la pèche du câble à réparer. |
Le local technique du personnel
chargé
de la réparation. |
Quelques échantillons de câbles
et de kits de jointage. |
Vue vers la plage avant.
Allons faire un tour... |
| |
|
Ce curieux tracteur, est remorqué sur le fond
et porte des griffes variées, pour accrocher le câble à
remonter. Appelé "tracteur" à cause de la forme
des roues, le terme technique correct
serait désensouilleur, son
rôle étant en effet de sortir un câble enfoui dans
sa souille.. |
Le ROV (Remotely Operated Vehicle) est un outil essentiel.
Celui ci, Hector, est de type omblical, il reste toujours relié
au navire par un cordon, dont le poids est soulagé par des bouées,
et qui sert à l'alimentation électrique, à la conduite
et à l'échange d'informations. Il est muni de pinces, de
multiples caméras, de buses projetant de l'eau. Il peut travailler
jusqu'aux environs de 2.000 m de fond. Au travail il suit le câble
en le chevauchant. C'est ainsi qu'il peut l'ensouiller. Il creuse une
tranchée au moyen de buses projetant un fort jet d'eau, dans laquelle
le câble tombe au fur et à mesure de l'avance. |
| Le davier arrière est muni d'une sorte de machoîre
pouvant bloquer le câble. |
Ce groupe, sur la plage arrière sert à
l'alimentation du ROV |
Plages de manœuvre avant et arrière sont abritées. |
La machine: sa propreté immaculée
est à l'honneur de l'équipe machine, et indique que ça
marche bien. On a le temps de garder propre, pas besoin de bouchon d'étoupe
pour la visite! |
|
Le navire est classé AUT, automatique, le quart n'est donc pas
nécessaire. La propulsion est électrique, avec deux lignes
d'arbres. Le courant est fourni par trois moteurs Crepell. Ce type de
propulsion, pas très courant, est bien adapté au positionnement
dynamique. Le carburant utilisé est du diesel.
Contrainte technique: le navire doit toujours être prêt à
appareiller dans un délai de 24 heures, ce qui ne permet pas des
travaux d'entretien trop longs sur les moteurs. Si on commence un démontage,
il faut être sûr de pouvoir remettre la machine en service
en moins de 24 heures s'il y a une demande d'intervention. |
| Le pc machine, avec vue sur le compartiment par de grandes
baies. |
|
Les trois moteurs Crepelle d'environ 1.500 kW chacun. |
Les moteurs diesel entraînent ces générateurs
électriques qui à leur tour alimentent les deux moteurs
électriques de propulsion.
A gauche le réfrigerant de la clim,
au fond une ligne
d'arbre. |
Les groupes électrogènes de servitude,
de 250
kW |
Les bouilleurs qui peuvent produire 5 m3 d'eau douce par jour,
moins que la consommation habituelle, l'autonomie
dépend donc des
caisses de stockage. |
Les séparateurs à combustible
et à huile |
| |
|
Les machines à câbles vues de dessous
avec
leurs tambours d'environ 4 m de diamètre. |
L'atelier équipé d'un
tour et d'une fraiseuse. |
| |
Un petit tour dans les emménagements
pour finir la visite: |
|
| Notes succinctes sur les câbles: |
|
|
|
| |
- contrairement à une idée répandue, le gros du trafic de communications passe par câbles et non par satelittes.
- rien qu'en Atlantique, entre Europe et Amériques, on en compte environ 180.000 km.
- les câbles autrefois en cuivre sont désormais composés d'une âme de fibres optiques extêmement fines, qui acheminent les signaux. Cette âme est protégée par une enveloppe en matière plastique, puis entourée d'une gaine de cuivre qui sert à alimenter en énergie les répéteurs. Ces relais sont nécessaires tous les 200 kms au maximum pour redonner sa vigueur au signal. L'ensemble est de nouveau entouré de gaines de protection.
- plus le câble est immergé profondément moins il a besoin de protection. Par moins de 200 m il a une double ou triple armure. Le danger d'avarie provient en effet des chalutiers à 90 pour cent. Avec l'évolution des techniques de chalutage les câbles peuvent maintenant être endommagés par un chalut jusqu'à 1.500 mètres de profondeur et même plus. |
|