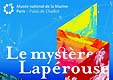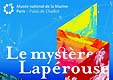Alors que la Marine Nationale et l'Association Salomon (Nouméa, Président Alain Conan) repartent à Vanikoro, lieu du naufrage de la BOUSSOLE et de l'ASTROLABE, les deux frégates de l'expédition Lapérouse, pour une huitième et sans doute dernière mission sur site (10 mai-11 juin 2008), le Musée national de la Marine propose, jusqu'en octobre, une superbe exposition consacrée à la disparition, en 1788, des 220 marins et savants français conduits par le Commandant Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse.
Cette exposition nous fait revivre une extraordinaire aventure planétaire de trois années qui devait s'arrêter brutalement dans les Iles Salomon, quelque part dans le Pacifique Sud. Une magnifique scénographie met en valeur les motivations qui ont poussé marins et savants, en plein siècle des lumières, à risquer leur vie pour découvrir de nouvelles terres et faire avancer la science.
L'exposition présente un grand nombre d'objets mis à jour lors des précédentes campagnes de fouilles, tant en mer (sur les épaves) qu'à terre (où l'on sait aujourd'hui que des survivants on vécu). Très émouvant.
|
|
|